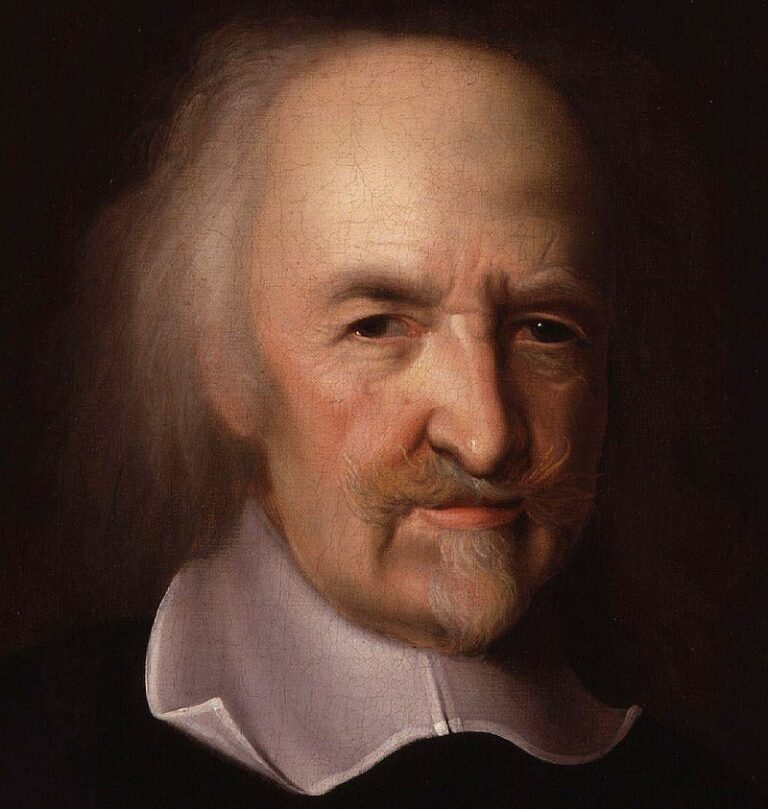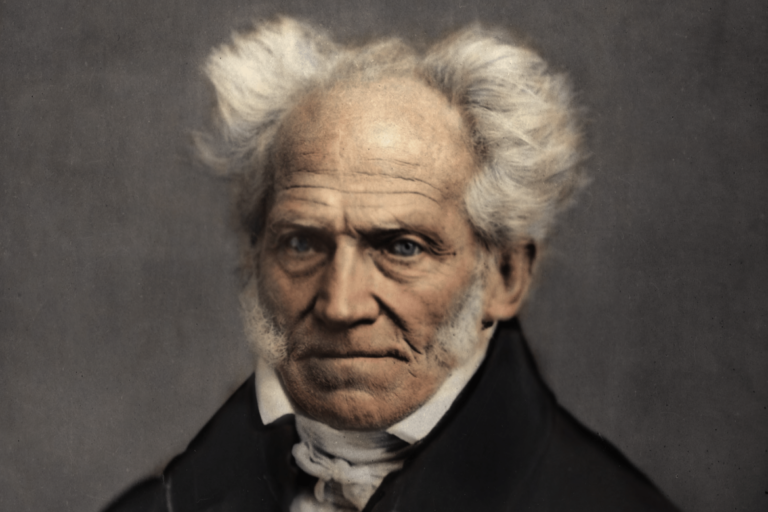De l’idée à l’expérience sociale de la nature : quand le mode de production dicte sa loi
Vendredi 23 janvier 2026, 18 h 00, Maison des Associations, 3, place Guy Hersant, Toulouse. Conférence de M. Jean-Axel DE FREITES, agrégatif à l’INSPE de Toulouse Occitanie Pyrénées. L’émergence dans les années 2000 d’un marxisme écologique aux États-Unis (Foster, 2000)…